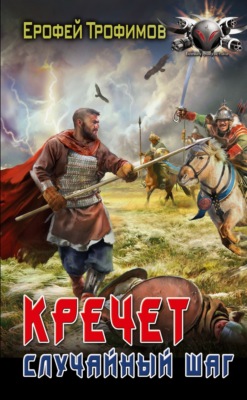Czytaj książkę: «Mémoires touchant la vie et les ecrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 4»
CHAPITRE I.
1671
L'abbé de Livry fait donation de tout son bien à madame de Sévigné.—Elle part pour la campagne.—Détails sur son voyage.—Elle arrive aux Rochers.—Effet que produit sur elle ce séjour.—Elle désirait ne pas le quitter, et y attirer sa fille.—Elle se passionne pour la solitude et les occupations champêtres.—Elle fait agrandir et embellir son parc.—Elle préfère Pilois, son jardinier, à tous les beaux esprits de la cour.—Elle participe à ses travaux.—Des causes qui ont produit le contraste de ses goûts et de son caractère.—Du plaisir qu'elle avait à recevoir les visites de Pomenars.—Détails sur celui-ci.—Madame de Sévigné n'aimait pas la société de province.—Son existence était celle d'une femme de cour ou d'une châtelaine.—Elle voit arriver avec peine l'époque des états.—N'est pas décidée à y assister.—Elle craint la dépense; donne à sa fille le détail de ses biens.—Elle se décide à assister aux états.—Détails sur les députés des états que connaissait madame de Grignan.—Tonquedec.—Le comte des Chapelles.—Mort de Montigny, évêque de Saint-Pol de Léon.—Des personnages qui composaient les états de Bretagne.—Soumission de ces états aux volontés du roi.—Différents de ceux de Provence.—Réjouissances et festins.—Supériorité des Bretons pour la danse.—Madame de Sévigné à Vitré.—Elle reçoit toute la haute noblesse des états aux Rochers.—Fin des états.—Bel aspect qu'offrait cette assemblée.—Détails sur les biens que possédait la famille de Sévigné.—Terre de Sévigné, aliénée depuis longtemps.—Terre des Rochers.—Tour de Sévigné, à Vitré.—Madame de Sévigné fait réparer son hôtel aux frais des états.—Terre de Buron.—Pourquoi madame de Sévigné ne s'y rend pas.—État de dégradation de ce domaine.—Toute sa vie madame de Sévigné s'occupe à embellir les Rochers.—Elle fait de nouvelles allées.—Met partout des inscriptions.—Les pavillons.—Le mail.—La chapelle.—Le labyrinthe et l'écho.
Près de deux mois s'étaient écoulés depuis la clôture des états de Provence1, lorsque, le 18 mai 1671, madame de Sévigné, dont le séjour à Paris et la présence à la cour n'étaient plus utiles à sa fille, monta dans sa calèche pour se rendre aux états de Bretagne. Son oncle, le bon abbé de Livry, qui avant de partir venait de lui faire donation de tout son bien2, et son fils, qu'elle dérobait à un genre de vie aussi nuisible à sa santé qu'à sa fortune, l'accompagnèrent. Le petit abbé de la Mousse, dont elle ne se séparait pas plus que de Marphise, sa chienne3, était aussi du voyage. Ainsi entourée, ayant dans sa poche le portrait de sa fille, et escortée de ses gens, elle alla coucher à Bonnelles, sur la route de Chartres; c'est-à-dire qu'elle ne parcourut ce premier jour que quarante kilomètres, ou dix lieues de poste. Son équipage se composait de sept chevaux.
Cinq jours après, le 23 mai, elle arriva à Malicorne, dans le château du marquis de Lavardin4, où elle se délassa de ses fatigues, et fit bonne chère. La route parcourue depuis Bonnelles, en passant par le Mans et la Suze, était de 202 kilomètres, ou de 51 lieues de poste. Elle fit encore cette fois dix à onze lieues par jour.
Les 94 kilomètres ou 22 lieues de distance qui lui restaient à parcourir furent franchis en deux jours, et madame de Sévigné arriva un jour plus tard que ne l'avait annoncé par mégarde le bon abbé de Livry; ce qui fut une contrariété pour Vaillant, son régisseur, qui avait mis plus de quinze cents hommes sous les armes pour la recevoir. Ils étaient allés l'attendre, la veille5, à une lieue des Rochers; ils s'en retournèrent à dix heures du soir, dans un grand désappointement. Partie le lundi, et arrivée seulement le mercredi de la semaine suivante, madame de Sévigné avait mis dix jours à faire un trajet de 336 kilomètres, ou 84 lieues6.
Du reste, elle n'avait éprouvé aucun ennui durant ces dix jours. Son fils, charmant pour elle, l'amusait par son esprit et sa gaieté; il lui déclamait des tragédies de Corneille, et la Mousse lui lisait Nicole. Elle regardait souvent le portrait de sa fille7; et lorsqu'en arrivant à Malicorne elle trouva une lettre d'elle, son plaisir fut grand, moins par la jouissance éprouvée à la lecture de cette lettre, que par l'assurance qu'elle y trouvait qu'une correspondance qui était le soutien de sa vie serait continuée avec régularité, et comme elle-même l'avait prescrit8.
La vue des Rochers, à la fin de mai, produisit sur madame de Sévigné son effet accoutumé: elle réveilla sa passion pour la campagne. A peine y fut-elle installée, qu'elle résolut de faire à son château des embellissements, d'y construire une chapelle, d'agrandir le parc9 et d'augmenter ses promenades. Ces travaux, qu'elle voulait diriger elle-même, exigeaient qu'elle fît à sa terre un assez long séjour. Aussi, dans la première lettre qu'elle écrivit à sa fille, datée des Rochers, trois jours après son arrivée, à la suite d'une phrase pleine de souvenirs mélancoliques, elle ajoute: «Si vous continuez de vous bien porter, ma chère enfant, je ne vous irai voir que l'année qui vient. La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles. C'est une chose étrange que les grands voyages! Si l'on était toujours dans le sentiment qu'on a quand on arrive, on ne sortirait jamais du lieu où l'on est; mais la Providence fait qu'on oublie. C'est la même chose qui sert aux femmes qui sont accouchées: Dieu permet cet oubli afin que le monde ne finisse pas, et que l'on fasse des voyages en Provence. Celui que j'y ferai me donnera la plus grande joie que je puisse recevoir de ma vie: mais quelles pensées tristes de ne point voir de fin à votre séjour! J'admire et je loue de plus en plus votre sagesse, quoique, à vous dire le vrai, je sois fortement touchée de cette impossibilité; j'espère qu'en ce temps-là nous verrons les choses d'une autre manière. Il faut bien l'espérer; car, sans cette consolation, il n'y aurait plus qu'à mourir10.»
Quelques jours après, elle ajoute encore: «Je ferais bien mieux de vous dire combien je vous aime tendrement, combien vous êtes les délices de mon cœur et de ma vie, et ce que je souffre tous les jours quand je fais réflexion en quel endroit la Providence vous a placée. Voilà de quoi se compose ma bile: je souhaite que vous n'en composiez pas la vôtre; vous n'en avez pas besoin dans l'état où vous êtes [madame de Grignan était enceinte]. Vous avez un mari qui vous adore: rien ne manque à votre grandeur. Tâchez seulement de faire quelque miracle à vos affaires, afin que le retour à Paris ne soit retardé que par le devoir de votre charge, et point par nécessité11.»
On voit par ces passages, et par tout le reste de la correspondance12 de madame de Sévigné, que si elle différa pendant plus d'un an encore son voyage de Provence, ce n'est pas que le désir de se réunir à sa fille fût en elle moins ardent; mais c'est qu'elle espérait toujours l'attirer près d'elle, et être dispensée d'un déplacement qui lui pesait. Madame de Grignan lui avait dit qu'il lui était impossible de quitter la Provence, parce que son mari, obligé à une continuelle représentation, avait besoin d'elle. En effet, il y avait cette différence entre les états de Bretagne et ceux de Provence, que ces derniers avaient lieu tous les ans, et les premiers tous les deux ans: ceux-ci d'ailleurs présentaient moins de difficulté aux gouverneurs, qui obtenaient facilement le vote de l'impôt. Ce sont ces considérations mêmes qui faisaient que madame de Sévigné redoutait d'aller en Provence. C'était sa fille qu'elle voulait, c'était sa présence, sa société, ses confidences, ses causeries, ses épanchements, dont elle était avide, et non pas de devenir le témoin des belles manières, de la dignité, de la prudence de la femme de M. le lieutenant général gouverneur de Provence, présidant un cercle ou faisant les honneurs d'un grand repas. C'est à Livry, c'est aux Rochers qu'elle aurait voulu posséder madame de Grignan, la réunir à son aimable frère, et jouir de tous les deux13, sans distraction, dans les délices de la solitude: c'était là son rêve chéri, sa plus vive espérance. Aussi parvint-elle à rendre possible ce qui avait d'abord été trouvé impossible; et elle eut raison de croire qu'un jour viendrait où l'on verrait les choses d'une autre manière14.
Ce qui étonne le plus dans madame de Sévigné, c'est cette nature vive, passionnée, flexible, variable, apte à recevoir les impressions les plus opposées, à s'en laisser alternativement dominer. Femme du grand monde, elle y plaît, elle s'y plaît; son tourbillon l'amuse, elle est occupée de ce qui s'y passe; elle est attentive à ses travers, à ses ridicules, à ses modes, à ses caprices; agréablement flattée de tout ce qui est de bon goût, de bon ton; recherchant les beaux esprits, admirant les talents, aimant la comédie, la danse, les vers, la musique; se laissant aller avec une sorte d'entraînement à tout ce que peut donner de jouissance une société opulente, élégante et polie; puis tout à coup, une fois transportée dans son agreste domaine, devenue étrangère à tout cela, dégoûtée de tout cela, obsédée et ennuyée des nouvelles de cour15 qui lui arrivent, et considérant comme une tâche pénible l'obligation de paraître s'intéresser au mariage du premier prince du sang, et d'être forcée de répondre et de lire les détails qu'on lui donne sur ce sujet; ne songeant plus qu'au plaisir de vivre tous les jours avec les siens sous un même toit, de lire les livres qu'elle aime, de broder, d'écrire à sa fille, de supputer les produits de ses terres, de planter, de cultiver, de braver pour cette besogne les intempéries de l'air et tous les inconvénients attachés aux travaux champêtres; de se promener sur ses coteaux sauvages et dans ses bois incultes, non sans la crainte d'être dévorée par les loups, non sans s'astreindre à se faire protéger par les fusils de quatre gardes-chasses, l'intrépide Beaulieu à leur tête16.
Elle écrit à sa fille: «La compagnie que j'ai ici me plaît fort; notre abbé (l'abbé de Livry) est toujours admirable; mon fils et la Mousse s'accommodent fort bien de moi, et moi d'eux; nous nous cherchons toujours; et quand les affaires me séparent d'eux, ils sont au désespoir, et me trouvent ridicule de préférer un compte17 de fermier aux contes de la Fontaine.»
Le bon abbé examine ses baux, s'instruit sur la manière d'augmenter les revenus, soigne la construction de la chapelle; madame de Sévigné brode un devant d'autel18. Le baron de Sévigné l'avait remise en train de recommencer les lectures de sa jeunesse; il lui déclame de beaux vers; elle compose avec lui de jolies chansons qui obtiennent les éloges de madame de Grignan. Pour achever d'apprendre l'italien à la Mousse, madame de Sévigné relit avec lui le Tasse19. Lui, fait le catéchisme aux petits enfants20. Madame de Sévigné prétend qu'il n'aspire au salut que par curiosité, et pour mieux connaître ce qu'il en est sur les tourbillons de Descartes: enfin elle se rit de posséder chez elle trois abbés qui font admirablement leurs personnages, mais dont pas un, dit-elle, ne peut lui dire la messe, dont elle a besoin21.
Tout cela est naturel: mais qu'après avoir reçu, la veille de son départ pour la Bretagne, les adieux de tous ses amis, dans un grand repas qui lui a été donné par Coulanges, la châtelaine des Rochers soit devenue tellement campagnarde qu'en parlant à sa fille de ce dîner, elle ne lui donne qu'une seule ligne22; que tant de personnes qui la chérissent, et la redemandent comme l'âme de leur cercle, comme une compagne charmante, comme une amie toujours sûre, ne lui inspirent jamais, pendant son séjour aux Rochers, une seule fois le regret de les avoir quittées; qu'elle ne soit sensible à une telle séparation que parce qu'elle lui ôte les moyens de donner à sa fille des nouvelles de Paris et de la cour, et de la priver pour sa correspondance de sujets qui peuvent l'intéresser et l'amuser, voilà ce qui étonne. Pilois, son jardinier23, est devenu pour elle un être plus important que tous les beaux esprits et les grands personnages de l'hôtel de la Rochefoucauld. Elle préfère son bon sens, ses lumières, à tous les entretiens des courtisans, des académiciens et des alcôvistes. Elle ne le dirige pas dans ses travaux, elle les dirige avec lui. Elle marche dans les plus hautes herbes, et se mouille jusqu'aux genoux, pour l'aider dans ses alignements24; et lorsqu'en décembre le froid rigoureux a chassé d'auprès d'elle et ses hôtes et ses gens, elle reste courageusement avec Pilois; elle tient entre ses mains délicates, devenues robustes, l'arbre qu'il va planter, et qu'elle doit avec lui enfoncer en terre25. Une si complète transformation, une si grande métamorphose étonne et charme à la fois.
Elle se conçoit cependant quand on a bien compris madame de Sévigné; quand on est initié, par l'étude de toute sa vie, aux sentiments, aux inclinations dont elle subissait l'influence. Introduite par son jeune mari dans le tourbillon du grand monde, elle y prit goût; elle fut glorieuse des succès qu'elle y obtint. Elle se livra avec abandon aux jouissances que lui facilitaient son âge, sa beauté, sa santé, sa fortune, la gaieté de son caractère; mais, trompée et presque répudiée par cet époux en qui elle avait placé ses plus tendres affections, elle connut de bonne heure des peines dont le monde et ses plaisirs ne pouvaient la distraire. L'éducation qu'elle avait reçue, et son excellent naturel, lui firent chercher un soulagement dans la religion, la lecture, et les occupations domestiques. Elle se trouva ainsi partagée entre le besoin des distractions et de l'agitation mondaines, entre les plaisirs et les tranquilles et uniformes jouissances de la retraite, entre Paris, Livry, les Rochers. Mais dans sa brillante jeunesse, avec le goût qu'elle avait pour la lecture des romans, pour ces sociétés aimables, joyeuses et licencieuses de la Fronde, dans lesquelles elle se trouvait lancée, les remèdes qu'elle employait n'étaient pour son mal que des palliatifs momentanés26. Son cœur avide d'émotions n'eût pu échapper aux tortures de la jalousie et de l'amour rebuté qu'en cédant aux ressentiments que lui faisaient éprouver les infidélités de son mari, et l'injurieux abandon dont il la rendait victime. Ce n'était qu'en triomphant de l'amour conjugal par un autre amour, il est vrai, moins légitime, mais peut-être plus digne d'elle, qu'elle pouvait, à l'exemple de tant d'autres, en ce temps de débordement des mœurs, se consoler de son malheur, et ressaisir les avantages de sa jeunesse. Plusieurs espérèrent; et Bussy n'aurait peut-être pas espéré en vain, si cette situation, capable de dompter le plus indomptable courage, se fût longtemps prolongée27. Mais elle cessa, par une horrible catastrophe qui porta le désespoir dans le cœur de madame de Sévigné. Son mari, si jeune, si beau, lui fut enlevé par une mort violente, qui semblait lui avoir été infligée pour son inconduite, et comme une juste punition des torts qu'il avait envers elle. Alors ces torts disparurent à ses yeux; elle ne se souvint plus que de ce qu'il avait d'aimable; elle ne ressentit plus que la douleur d'en être privée pour toujours, lorsqu'il l'avait rendue deux fois mère. Et cette douleur dura longtemps: cette flamme allumée en elle par l'amour conjugal tourna tout entière au profit de l'amour maternel; comme celle de Vesta, elle brûla pure dans son cœur agité, sans faire éclater aucun incendie ni produire aucun désordre dans ses sens. La religion communiqua à sa vertu la force et la fierté dont elle avait besoin pour se soustraire aux écueils et aux dangers de l'âge périlleux qu'elle avait à traverser, et elle put se consacrer à l'éducation de ses enfants d'une manière qui la rendit l'admiration du monde28. Mais dès lors ce monde perdait chaque jour de l'attrait qu'il avait eu pour elle: plus elle en appréciait le faux, le vide, les vices et les ridicules, plus ses inclinations à la retraite, et le goût de la campagne, qu'elle avait contracté dans sa jeunesse, prenaient sur elle de l'empire. Là elle vivait plus pour ses enfants, pour le bon abbé, pour elle-même; et c'est la vivacité de ces sentiments qui donne cette fois aux lettres qu'elle a écrites des Rochers, dans le cours de l'année dont nous traitons, un charme supérieur à celles qui sont datées de Paris. Ces lettres écrites des Rochers sont sans doute plus dépourvues de tout ce qui peut les rendre historiquement intéressantes. Elles abondent en détails futiles, mais charmants par le tour qu'elle sait leur donner. Il y a plus d'imagination, plus d'esprit même, plus de talent de style que dans les autres; et ce sont sans doute celles-là qui, de son temps, ont fait sa réputation. Les lettres qui renfermaient des détails sur de grands personnages, et des nouvelles de cour, ne pouvaient être montrées ni par madame de Grignan, ni par Coulanges, ni par les amis de cour auxquels elle écrivait, tandis qu'on communiquait sans difficulté et sans inconvénient celles du laquais Picard, renvoyé pour avoir refusé de faner29; celles où elle s'amuse avec trop peu de charité aux dépens des Bretons et de leurs familles30, et de toutes les femmes de la Bretagne que la tenue des états réunissait à Vitré31.
On conçoit que madame de Grignan ne manquât pas de communiquer à ses amis les lettres où sa mère se plaisait à lutter avec les beaux esprits ses amis, par la composition de ses devises32; mais rien ne prouve mieux que la licence et le relâchement des mœurs des temps de la Fronde subsistaient encore, que de trouver dans ces mêmes lettres l'aveu du plaisir qu'avait madame de Sévigné à recevoir les visites du marquis de Pomenars, du divin Pomenars, ainsi qu'elle l'appelle, parce que cet homme l'amusait par la gaieté et les saillies de son esprit. Ce gentilhomme breton, effrontément dépravé, passait sa vie sous le coup d'accusations et même de condamnations capitales. Si le roi avait ordonné qu'on tînt en Bretagne les grands jours, comme autrefois en Auvergne et en Poitou, Pomenars n'aurait certainement pas échappé aux châtiments infligés par les juges de ces redoutables assises. Il avait été accusé de fausse monnaie; il fut absous, et paya les épices de son arrêt en fausses espèces33. Il paraît qu'un nouveau procès s'était renouvelé contre lui, peut-être pour ce dernier méfait; et de plus il se trouvait encore poursuivi pour avoir enlevé la fille du comte de Créance. Tout cela ne le rendait pas plus triste, tout cela ne l'empêchait pas de venir aux états, et d'y montrer tant d'audace et d'impudence, que «journellement, dit madame de Sévigné, il fait quitter la place au premier président, dont il est ennemi, aussi bien que du procureur général34.» Il allait chez la duchesse de Chaulnes aux Rochers, partout où il pouvait s'amuser35. Il sollicitait gaiement ses juges avec une longue barbe, parce que, avant de se donner la peine de la raser, il fallait, disait-il, savoir si sa tête, que le roi lui disputait, lui resterait. Il est probable que quand il parlait ainsi, c'est de l'accusation de fausse monnaie qu'il était question. L'autre accusation était d'une nature moins grave. Il s'agissait de la demoiselle de Bouillé, fille de René de Bouillé, comte de Créance, et cousine de la duchesse du Lude; cette demoiselle qui, après avoir vécu quatorze ans avec Pomenars, s'avisa un jour de le quitter, de se rendre à Paris, et de le faire poursuivre pour crime de rapt36. «Pomenars, dit madame de Sévigné à sa fille, qui s'intéressait beaucoup à ce gentilhomme qu'elle connaissait, ne fait que de sortir de ma chambre. Nous avons parlé assez sérieusement de ses affaires, qui ne sont jamais de moins que de la tête. Le comte de Créance veut à toute force qu'il l'ait coupée, Pomenars ne veut pas: voilà le procès37.»
Il fut jugé et condamné par contumace cinq mois après, et fit aux Rochers une nouvelle visite à madame de Sévigné, qui raconte ainsi ce fait à sa fille: «L'autre jour, Pomenars passa par ici; il venait de Laval, où il trouva une grande assemblée de peuple; il demanda ce que c'était: C'est, lui dit-on, que l'on pend un gentilhomme qui avait enlevé la fille du comte de Créance. Cet homme-là, sire, c'était lui-même38. Il approcha, il trouva que le peintre l'avait mal habillé; il s'en plaignit; il alla souper et coucher chez les juges qui l'avaient condamné. Le lendemain, il vint ici se pâmant de rire; il en partit cependant de grand matin le jour d'après39.» Il se rendit ensuite à Paris, et nous le retrouvons assistant à une représentation de Bajazet, où était madame de Sévigné. «Au-dessus de M. le duc, dit-elle, était Pomenars avec les laquais, le nez dans son manteau, parce que le comte de Créance le veut faire pendre, quelque résistance qu'il fasse40.»
Pour qui ne connaît pas ces temps, tout paraît mystérieux dans la vie de ce don Juan breton, et dans l'indulgence dont il était l'objet. Les témoignages d'amitié que ne craignaient pas de lui donner des personnes recommandables sont une chose si étrange, qu'ils ont besoin de quelques explications. Nous apprenons que, huit jours après cette représentation de Bajazet, Pomenars fut taillé de la pierre; qu'il reçut la visite de la duchesse de Chaulnes et de madame de Sévigné. Elle écrit à sa fille: «Madame de Chaulnes m'a donné l'exemple de l'aller voir. Sa pierre est grosse comme un petit œuf: il caquette comme une accouchée; il a plus de joie qu'il n'a eu de douleur; et, pour accomplir la prophétie de M. de Maillé, qui dit à Pomenars qu'il ne mourrait jamais sans confession, il a été, avant l'opération, à confesse au grand Bourdaloue. Ah! c'était une belle confession que celle-là! il y fut quatre heures. Je lui ai demandé s'il avait tout dit; il m'a juré que oui, et qu'il ne pesait pas un grain. Il n'a point langui du tout après l'absolution, et la chose s'est fort bien passée. Il y avait huit ou dix ans qu'il ne s'était confessé, et c'était le mieux. Il me parla de vous, et ne pouvait se taire, tant il est gaillard41.»
On ne peut douter que madame de Sévigné et la duchesse de Chaulnes ne fussent parfaitement instruites de la vie scandaleuse de Pomenars. Madame de Sévigné, quinze jours après la lettre que nous venons de citer, ayant à mander à sa fille cet affreux procès de la Voisin l'empoisonneuse, dans lequel tant de grands personnages se trouvèrent compromis, lui dit: «Pomenars a été taillé; vous l'ai-je dit? Je l'ai vu; c'est un plaisir que de l'entendre parler de tous ces poisons; on est tenté de lui dire: Est-il possible que ce seul crime vous soit inconnu42?»
Ceci nous apprend que Pomenars parlait avec chaleur contre la comtesse de Soissons, dont la fuite prouvait la complicité avec la célèbre empoisonneuse, et que cette ardeur contre de tels coupables étonnait madame de Sévigné, sans que pourtant elle crût Pomenars capable d'un tel crime. Ce qu'elle a dit de lui démontre qu'elle le connaissait depuis longtemps43. Il était probablement, avec Tonquedec, au nombre de ces gentilshommes bretons qui, an temps de la Fronde, fréquentaient sa maison comme amis de son mari, devenus ensuite les siens. Il est évident qu'il était protégé à la cour par des hommes puissants, contre les ennemis qu'il s'était faits dans sa province et contre les juges qui l'avaient condamné. Le procès qui lui fut intenté pour fausse monnaie était ancien, et datait probablement de cette époque où, en haine de Mazarin, tout paraissait permis contre le gouvernement, alors que les auteurs ou complices de tels brigandages ne perdaient pas pour cela la qualification d'honnêtes hommes44. Ce qui me confirme dans cette idée, c'est que madame de Sévigné dit que Pomenars se mettait peu en peine de son affaire de fausse monnaie45.
Louis XIV, qui exilait le mari de madame de Montespan, ne pouvait apprendre avec plaisir que mademoiselle de Bouillé, pour se venger d'un amant dont l'amour était éteint, l'eût fait poursuivre comme ravisseur, et que des juges de province eussent osé prononcer la peine capitale contre un gentilhomme, pour un fait de galanterie avec une femme non mariée.
Lorsque la duchesse de Chaulnes et madame de Sévigné allèrent voir Pomenars à Paris, on lui avait fait grâce ou il avait purgé sa contumace, car madame de Sévigné n'en parle plus. A Vitré et aux Rochers, Pomenars, par sa gaieté, ses manières, son langage, lui rappelait sa folle jeunesse et les aimables factieux d'une époque de joyeux désordres. Pomenars lui avait aidé à supporter les ennuis d'une ville de province et de la tenue des états. Autant elle se plaisait dans ses domaines, dans ses vastes campagnes, au milieu des siens, de ses vassaux, de ses domestiques et de ses paysans, autant elle redoutait les sociétés prétentieuses, les fatigantes formalités, l'insipidité des entretiens, et les ridicules susceptibilités de la province. Femme de cour et châtelaine, elle avait toutes les perfections et les imperfections attachées à ces deux titres: les premières, elle les tenait de son excellent naturel; les secondes, elle les devait à son éducation, au temps où elle vivait, et aux habitudes de toute sa vie. De là ses préférences pour la haute noblesse, pour tous ceux qui vivaient à la cour; son indulgence pour leurs travers, sa sympathie pour leurs vaniteuses prétentions; son dédain pour la petite noblesse, qui singeait gauchement les manières et le langage des grands, qui s'empressait auprès d'eux, qui les obsédait de ses attentions, qui les fatiguait par sa déférence46, mais qui, franche, généreuse, sensible, serviable, pleine d'honneur, par le contraste de plusieurs vertus essentielles avec les vices des gens de cour leur était, après tout, infiniment préférable. Si tel était l'éloignement de madame de Sévigné pour une classe avec laquelle elle se trouvait obligée de frayer occasionnellement, on pense bien qu'elle éprouve encore moins de penchant pour les personnes placées sur des degrés plus bas de l'échelle sociale, pour les classes bourgeoises. Celles-là, elle les réunit toutes dans une même et dédaigneuse indifférence; mais elle était bonne et indulgente pour la classe la plus infime, parce que c'est elle qui peut lui servir à exercer sa charité; c'est avec elle qu'elle est dispensée de toute réciprocité pour tout ce qu'on appelle les devoirs de société. Ce défaut du caractère de madame de Sévigné ne lui était pas particulier; il lui était au contraire commun avec tous les gens de cour, et il était encore plus prononcé chez quelques-uns. Dans le monde où elle vivait, de telles pensées étaient plutôt un sujet d'éloge que de blâme. Mais il n'en pouvait être de même de nos jours; et madame de Sévigné a dû déplaire par là à une génération si opposée, dans la théorie, à de semblables opinions, si fort disposée à se louer elle-même et à traiter rudement les sentiments des générations qui l'ont précédée. C'est surtout durant cette année 1671, et pendant la tenue des états de Bretagne47, que se manifestent le plus ces répulsions et ces dédains, qui ont valu à la marquise de Sévigné un blâme mérité, et aussi de brutales injures, de la part des critiques, qui ne se doutent nullement combien ils sont eux-mêmes aveuglés par les vulgaires préjugés de leur siècle.
Ainsi donc, qu'on ne s'y méprenne pas: si madame de Sévigné se fit chérir en Bretagne, tandis que madame de Grignan ne sut pas se concilier l'affection des Provençaux, ce n'est pas que cette dernière fit moins pour ceux-ci que sa mère pour les Bretons: au contraire, madame de Grignan et son mari agissaient grandement, et faisaient avec profusion les honneurs du rang qu'ils occupaient. Mais madame de Grignan, altière, ambitieuse48, avait acquis un grand ascendant sur son mari et sur toute la famille des Grignan. Elle était devenue l'âme d'un parti opposé à celui de l'évêque de Marseille; elle avait une réputation de haute capacité; elle s'était fait beaucoup de partisans et beaucoup d'ennemis. Madame de Sévigné, au contraire, n'avait point de partisans, mais elle comptait beaucoup d'amis. Quand elle était aux Rochers, elle restreignait ses dépenses; elle éludait ou refusait toutes les invitations, n'en faisait point, et ne recevait dans son château que ses parents et ses amis de cour ou de Paris. Mais elle était moins froide, moins dissimulée, moins formaliste que sa fille. En sa présence, on se trouvait à l'aise; vive et expansive, elle parlait beaucoup et sans prétention; et on l'aimait, parce qu'elle se montrait toujours aimable. On lui pardonnait de peu communiquer avec ses voisins, de se montrer rarement à Vitré, et de se cantonner aux Rochers; mais elle faisait dans ce lieu de longs séjours, et, de la manière dont elle l'embellissait, il était évident qu'elle s'y plaisait, qu'elle aimait la Bretagne, et par conséquent ses habitants: c'était, on le croyait, une bonne Bretonne, les délices et l'honneur de la province. Sans doute telle est l'opinion qu'elle eût laissée d'elle pour toujours dans ce pays, si ses lettres à sa fille n'avaient pas détruit cette illusion.
Les confessions faites sous la forme de mémoires, quelque sincères qu'on les suppose, ne sont jamais entières ni parfaitement vraies, parce que, dans ces sortes d'écrits, on omet de raconter certaines actions ou certaines manières de se conduire qui nous paraissent naturelles ou dignes de louanges, ou bien on les représente sous cet aspect favorable qui doit leur concilier l'approbation de tous les esprits: mais dans des lettres confidentielles, écrites dans le but de faire connaître à quelqu'un tous les mouvements de l'âme, toutes les agitations du cœur, toutes les incertitudes de la pensée, toutes les variations de la volonté, rien n'est dissimulé, rien n'est omis; on apprend tout, on sait tout. Ainsi ces états de Bretagne, pour lesquels madame de Sévigné avait quitté Paris et différé son voyage en Provence, sa correspondance nous apprend qu'elle ne les vit approcher qu'avec peine49, et qu'elle eut la velléité de ne pas y assister et de retourner dans la capitale. «Je crois que je m'enfuirai, dit-elle, de peur d'être ruinée. C'est une belle chose que d'aller dépenser quatre ou cinq cents pistoles en fricassées et en dîners, pour l'honneur d'être de la maison de plaisance de monsieur et de madame de Chaulnes, de madame de Rohan, de M. de Lavardin et de toute la Bretagne50!»